- Services aux associations
- Boutique
- Besoin de discuter ?
- La FAGE
- Nos idées
- Innovation sociale
- Mes droits
- Événements
- Formations
- Actualités
- Espace Presse
11/04/2017
la sexualité est aujourd’hui très marquée par un clivage sur les représentations entre la sexualité masculine et celle féminine, par une meilleure acceptation sociale de l’homosexualité même si les réticences restent fortes lorsqu’il est question de l’homoparentalité, et par une forte demande d’égalité dans l’interaction sexuelle et la relation de couple au vue de l’augmentation des dénonciations de violences sexuelles.
Ces constats se retrouvent également dans la population jeune mais d’autres aspects entrent en ligne de compte : difficultés à trouver des informations non erronées, non normées, adaptées et égalitaires ; méconnaissance de leur corps en particulier chez les jeunes filles, amplification des phénomènes de réputation et de harcèlement du fait de la viralité des réseaux sociaux, responsabilisation des jeunes femmes au niveau de la prévention et de la protection, accès plus large à la pornographie, difficultés de mise en œuvre des politiques d’information et d’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’élargir l’approche sanitaire de la sexualité, jusque-là essentiellement axée sur une démarche de prévention des risques, à une approche positive et égalitaire, synonyme également de plaisir et d’épanouissement personnel. L’enjeu ne se situe pas uniquement sur des connaissances biologiques mais aussi, et essentiellement, sur des compétences psycho-sociales (respect mutuel, réciprocité et consentement des relations à l’autre).
Selon l’OMS (2002), « La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues ou exprimées simultanément. La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. »
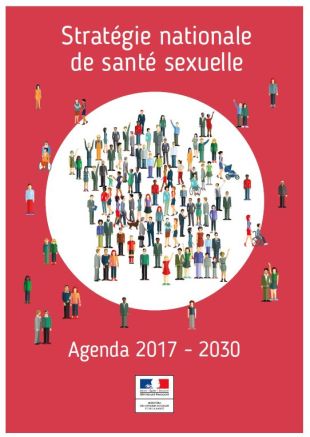

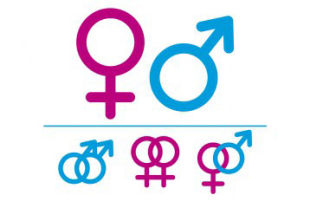
La FAGE se félicite de l’approche positive et égalitaire qui s’exprime en filigrane à travers l’ensemble de ce document et rappelle son attachement aux actions de promotion en santé sexuelle. En effet, face à la diversité des informations disponibles auprès des jeunes (Internet, réseaux sociaux, média jeunes, pornographie), il est nécessaire de les aider à identifier des données fiables et adaptées à leurs demandes, en partant de leur expérience et de leurs propres représentations.
L’éducation à la sexualité constitue donc un levier légitime de l’égalité entre les hommes et les femmes et entre les sexualités. Au vue des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre dans les établissements scolaires, reflet d’une société qui préfère nier la sexualité de ses jeunes, de nouveaux domaines doivent être investis comme les loisirs, l’insertion, l’éducation populaire, le sport. Au-delà des champs d’intervention, la démarche est aussi primordiale : il convient de partir de la parole des jeunes, sans jugement, sans discours moralisateur. Ainsi la prévention par les pairs, développée par le réseau de la FAGE, répond à ces enjeux. Fort d’un réseau d’étudiants en filière médicale et paramédicale mais aussi de responsables associatifs formés à ces questions, ces derniers ont à cœur d’agir auprès d’autres jeunes, dont ils partagent un certain nombre de préoccupations. En jouant leur rôle, ils souhaitent aborder la sexualité sous un angle global, afin de réduire le morcellement de cette thématique à une multitude de programmes et d’actions, déconnectées les unes des autres.

« Le constat est unanime : la
France est très en retard sur la mise en œuvre de l’éducation à la santé, et
particulièrement sur la thématique de la santé sexuelle, la caractérisant comme
« tabou » au sein de l’esprit collectif.
Les
sages-femmes et les étudiants sages-femmes, de part leur formation et leurs
compétences, sont des acteurs centraux de la santé sexuelle, c’est leur cœur de
métier. D’ailleurs
les 33 associations d’étudiant.e.s sages-femmes de France s’investissent de
plus en plus dans la mise en place
d’actions d’éducation à la santé sexuelle à destination des jeunes, collégiens
et lycéens en particulier. Certaines écoles intègrent pleinement ces
actions dans la formation par la validation d’ECTS.
Ainsi l’Anesf est enchantée de la mise en
place de cette stratégie à laquelle elle aura à cœur de participer pleinement,
via le projet HERA lancé en février dernier. »
Eléonore Bleuzen, Présidente, Anesf

« Depuis un demi-siècle, l'approche à la sexualité a beaucoup
évolué. En 1960, on commercialisait la première pilule contraceptive aux
Etats-Unis, au même moment on voyait apparaître le mouvement pour le planning familial
français. Dans les années 70, on a vu l'apparition des premières « gay
pride » ou « Marches des fiertés », et à la fin des années 80
l'apparition du SIDA.
Pourtant, en 2017, les
couples homosexuels sont toujours discriminés, le SIDA n'a pas disparu et les accidents de contraception et grossesses
non-désirées restent des événements courants. La stratégie nationale de
santé sexuelle répond en ce sens à un réel enjeu.
A notre échelle, l'ANEPF s'engage avec l'ANESF dans une campagne à venir sur la contraception, puisque
le choix d'une méthode adaptée aux pratiques de vie reste indispensable pour
éviter tout accident. L'engagement de nos réseaux contre les
discriminations et pour la prévention des IST reste également particulièrement
fort lors des événements que nous organisons. »
Anthony Mascle, Président, ANEPF

« Aborder la santé
sexuelle, le rapport au corps, qu'il soit nôtre ou celui d'un autre, ne
s'improvise pas. Les kinésithérapeutes participent à la prise en charge des
patients atteints d'affections de longue durée qui peuvent fortement limiter la
vie sexuelle. Professionnel du soin par
le mouvement et pour le mouvement, le kinésithérapeute est un acteur-clé de la
démarche d'acceptation de son corps, de ses limites, mais aussi de ses
possibilités.
Les associations étudiantes s'engagent pour créer un espace de
dialogue avec les associations de patients, pour un rétablissement de l'échange
entre le soignant et le patient, afin que les sujets les plus intimes puissent
être abordés en pleine confiance. »
Juliette Quentin, Présidente, FNEK

« Les soins infirmiers ont beaucoup évolué
depuis les dernières années. La
sexualité des patient.e.s commence à prendre une part de plus en plus
importante dans leur analyse de soins. Ainsi cela devient une catégorie de
données à part entière au sein des différentes méthodes de diagnostics
infirmiers tel que ceux proposés par Marjorie Gordon
ou Virginia Henderson.
Au niveau étudiant, la FNESI s'engage et prône la fin des inégalités Femme/Homme, la
cessation des discriminations, et effectue la promotion de la prévention des
IST lors de ses différents événements. De même au cours des dernières
années, la FNESI et son réseau se sont engagés depuis plusieurs années dans des
projets de promotion de la santé sexuelle telle que le Sidaction. »
Clément Gautier, Président, FNESI
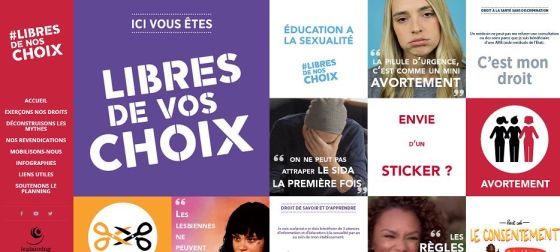
Nous suivre sur