- Services aux associations
- Boutique
- Besoin de discuter ?
- La FAGE
- Nos idées
- Innovation sociale
- Mes droits
- Événements
- Formations
- Actualités
- Espace Presse
16/02/2016
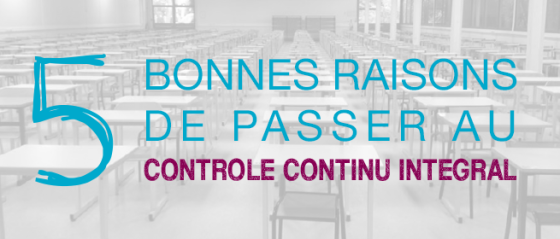
Depuis maintenant près de 6 ans, une révolution pédagogique est en marche. Très nettement plébiscitée par les étudiants des Universités de Strasbourg et d’Avignon dans lesquelles elle s’opère, le contrôle continue intégral révolutionne les modalités d’évaluation des étudiants et œuvre en faveur de la réussite de plus grand nombre. Il s’agit d’un outil pédagogique à part entière, largement plébiscité par la communauté universitaire pour en finir avec les partiels vieillissants et pédagogiquement peu pertinents en ce qu’ils ne donnent une vision que très partielle et contestable de l’acquisition de compétences et de la progression de l’étudiant.
Malgré l’intérêt mainte fois démontré du développement du contrôle continu intégral pour la réussite des étudiants, l’arrêté licence du 11 août 2011 qui définit les modalités d’évaluation ne prévoit pas le cadre nécessaire à sa mise en place. Bien évidement, des solutions peuvent être mises en place pour les Universités qui souhaitent adopter le contrôle continu intégral, en permettant par exemple la mise en place d’un statut d’expérimentation temporaire et dérogatoire, le temps d’évaluer encore une fois, s’il le faut, la pertinence du dispositif.
Cependant, alors qu’il sait, pour avoir suivi les expérimentations et reçu les acteurs concernés, que le contrôle continu intégral est un levier puissant d’augmentation du taux de réussite, le ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ne se donne aucun moyen pour aller de ce sens, pire, “ce n’est pas une priorité” (sic), reléguant la réussite étudiante et la rénovation de la pédagogie universitaire aux rangs secondaires des objectifs que se fixe le ministère. Pour favoriser la démocratisation de la réussite, on repassera !
Et pourtant, la mise en place du contrôle continu permettrait une augmentation sensible et générale de la réussite, et constituerait, pour au moins 5 bonnes raisons, une avancée majeure :

Proposant une approche formative et évaluant une progression tout le long de l’année, cette modalité de contrôle des compétences a permis à l'Université d'Avignon de faire progresser les taux de réussite de manière impressionnante. En licence AES, premier semestre, ce taux augmente de 11 % en 2008-2009 à 35 % en 2012-2013, ou encore le premier semestre de la licence informatique, où la réussite est passée de 25 à 54 %.

Le contrôle continu intégral apporte le droit à l’erreur et au rattrapage, détectant le plus tôt possible les éventuelles lacunes pour y apporter remède avant que ne s'installe la spirale de l'échec. Les évaluations régulières permettent ainsi d'identifier les difficultés des étudiants, de comprendre leurs erreurs. On adopte ici un réel modèle d’évaluation formative, basé sur la progression et non pas le contrôle d’un bachotage bien acquis.

En organisant une succession d’épreuves variées et adaptées à l’enseignement, tant sur le nombre que sur le format, le contrôle continu intégral diminue de manière significative le taux de décrochage. En effet, le taux d'abandon de la composante Sciences a baissé de 13,33 %, en Sciences Humaines et Sociales cette diminution est de 11,62 %. Enfin, ce chiffre correspond à 7,14 % de taux de décrochage en moins, pour l'ensemble de l'Université d’Avignon.

Dans une démarche d’assurance qualité, les évaluations sont nécessairement suivies d'une séance de correction. Cela permet de revenir sur des éléments de cours mal assimilés avant qu’il ne soit trop tard ! Avec l'appui des enseignants, l’évaluation continue permet donc à l'étudiant de progresser avant l'épreuve suivante et de consolider ses acquis. De plus, le contrôle continu intégral permet de mettre en exergue les compétences acquises toute renforçant leur apprentissage, conduisant de facto l’étudiant vers une meilleure insertion professionnelle.

L’ECI permet aussi d'allonger la durée d'enseignement faisant passer le nombre de semaines d’enseignement de 10 à 12 semaines par semestre. En effet, le rattrapage étant rendu inutile, les délais entre première et seconde session le sont aussi. Ce temps peut ainsi être réalloué à de l’enseignement ! Ainsi le temps passé à l'Université est optimisé et permet une meilleure progressivité dans l'appropriation des contenus pédagogiques, tout en favorisant la compréhension des liens entre les enseignements des diverses unités d'enseignement.
Le contrôle continu intégral apparaît comme une opportunité telle qu’on en observe peu dans le cadre de l’effort de démocratisation de la réussite. Accompagné de régimes spéciaux d’études permettant aux étudiants à rythmes contraints (salariés, parents, sportifs, etc..) d’aménager leurs agendas, d’obtenir des dérogations et de ne pas être pénalisés, il apparaît sans conteste comme le levier le plus puissant d’amélioration de la réussite ! A l’heure où les budgets se restreignent et où les sacrifices en faveur d’une rigueur budgétaire se multiplient, nous avons la possibilité de mettre en oeuvre rapidement -en modifiant quelques mots sur un arrêté- une mesure en faveur de la réussite des étudiants et sans impact budgétaire considérable pour les établissements.
Meilleure réussite, taux de décrochage en baisse, développement de l’approche compétence, meilleure employabilité … Le ministère est en capacité de permettre cette avancée pour tous en modifiant à la marge un article de l’arrêté licence, mais ne le fait pas. La FAGE, fatiguée d’attendre depuis des années cette mesure de bon sens, exige du gouvernement une prise de décision claire et rapide en faveur la réussite des tous les étudiants. A défaut, elle demande à Thierry Mandon d’expliquer publiquement les motifs de son refus de permettre à plus d’étudiants de réussir leurs études !
Nous suivre sur